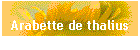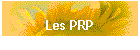Le Génome Mitochondrial
1) Introduction
La mitochondrie est un organite intracellulaire qui contient son propre génome. On y trouve donc de l’ADN mais aussi des ARN qui résultent de la transcription de l’ADN mitochondrial et des protéines qui proviennent de la traduction de ces ARN. L’ADN peut être libre dans la matrice ou ancré à la membrane interne de la mitochondrie.
Photo : Mise en évidence des ADN mit et nucléaire par microscopie de fluorescence dans une cellule d’Euglena gracilis en croissance :En vert, mitochondries; en rouge : ADN nucléaire ;En jaune : ADNmit car superposition du rouge de l’ADN avec le vert de la mitochondrie)
Le génome mitochondrial a évolué au cours du temps. Son évolution est étudié grâce à la comparaison des génome mitochondriaux des plantes.
Le génome mitochondrial des plantes fleurissantes est le plus complexe des eucaryotes. Au cours de l’évolution, peu de gènes ont été conservé.
2) Mise en évidence du génome mitochondrial : L’hérédité cytoplasmique ou hérédité mitochondriale
Le génome mitochondrial a été mis en évidence par Correns en 1910. Il recherchait l’origine des taches jaunes chez Mirabilis jalapa.
Il a réalisé de nombreux croisements entre phénotypes différents (il a considéré la couleur des branches), et il s’est aperçu que pour certains caractères, le phénotype de la mère domine toujours sur celui du père. Ces résultats ne correspondaient pas aux lois de Mendel et n’étaient pas dues aux gènes des chromosomes sexuels. De plus, il n’y avait jamais, pour ces caractères, de mélange de couleurs ni de proportion dans les résultats.
Il ne savait pas si ces résultats étaient dus aux mitochondries, aux chloroplastes ou aux plasmides. Aujourd’hui, on sait que la mitochondrie possède des gènes et que ceux-ci sont toujours transmis par la mère : lors de la fécondation, il y a fusion des deux gamètes au sein d’une cellule maternelle.
3) Compétition entre le génome mitochondrial et le génome nucléaire
La réplication de la mitochondrie et donc de son génome est constante au cours du temps afin que la cellule fille ait les mêmes informations et ceci en quantité égale, à celle de la cellule mère. Les gènes nucléaires sont transmis par le père et la mère tandis que les gènes mitochondriaux ne proviennent que de la mère : ces gènes sont appelés des gènes égoïstes.
Il existe un conflit nucléocytoplasmique, c’est à dire entre les gènes du noyau et ceux de la mitochondrie. Les gènes cytoplasmiques sont favorisés par rapport aux gènes nucléaires, mais si ceux de la mitochondrie le sont trop , le noyau va réagir en synthétisant des protéines.
Ex : Chez le thym, il y a 95% de plantes femelles et 5% de plantes hermaphrodites. Ceci présente un désavantage pour la reproduction. Au bout d’un certain temps, le noyau va réagir : il existe des gènes qui vont restaurer la fécondation mâle.
Systèmes multienzymatiques: Les protéines mitochondriales et nucléaires peuvent également travailler ensemble :
- La réplication de l’ADN mitochondrial est catalysée par l’ADN polymérase g qui est une protéine d’origine nucléaire.
- La cytochrome oxydase et l’ATP synthétase sont des systèmes multienzymatiques dont des sous-unités protéiques sont codées par le génome nucléaire et d’autres par le génome mitochondrial ? Cela nécessite une coordination de la synthèse protéique entre les deux génomes.
4) Formation du génome mitochondrial au cours de l’endosymbiose
La mitochondrie s’est formée par l’endosymbiose unique d’une bactérie de la classe des a-protéobactéries dans une cellule précurseur (la nature de la cellule est discutée par les scientifiques). Cette théorie est confirmée d’après la comparaison des séquences d’ADN mitochondrial avec celles d’une a-Protéobactérie (Rickettsia prowazekii qui est l’agent causal du typhus : c’est une bactérie parasite intracellulaire qui entre dans une cellule hôte par phagocytose). La bactérie est ensuite restée dans la cellule hôte et est devenue une promitochondrie : cette endosymbiose fut sans doute à bénéfices réciproques.
Le génome de la bactérie a été appelé le génome promitochondrial. Il y a eu ensuite simplification de ce génome :
- Des gènes de la promitochondrie ont migré vers le noyau.
- Apparition de séquences non codantes (Le génome mitochondrial d’A.thaliana mesure 366 kb et code seulement pour 32 protéines.).
- Arrivée massive d’introns.
On retrouve des morceaux d’ADN mitochondriaux au sein de l’ADN nucléaire et dans le génome chloroplastique. Des fragments d’ADN ont donc pu passer des organites au noyau, et entre les divers organites. On ne connaît pas encore la façon dont ces fragments se sont déplacer.
5) Particularités et utilisation du génome mitochondrial des plantes
- Particularités: Chez les plantes, le génome mitochondrial est constitué d’une série d’ADN fermés capables de se recombiner. Ils sont bien plus variables et plus grands que les ADNmit des autres organismes. Leur dimension va de 200.000 à 2.500.000 paires de bases (contre 3.109 pb pour le génome nucléaire). A l’intérieur même d’une famille, leur dimension peut varier jusqu'à huit fois (melon d’eau : 330.000 pb et melon musqué : 2.500.000 pb).
Les ARN ribosomaux des mitochondries végétales ont aussi une taille bien supérieure à ceux des mitochondries d’animaux ou de champignons, mais nous n’en connaissons pas encore la capacité codante.
Les ADN mit des végétaux comportent quelques gènes absents de l’ADN mit d’autres organismes, notamment celui qui code pour l’ARN 5S.
L’ADN mitochondrial des plantes code pour diverses protéines, comme par exemple :
- L’élément 26S, le petit élément 18S et l’ARN 5S de l’ARNr.
- environ 30 ARNt.
- Les protomères 1, 2 et 3 de la cytochrome oxydase.
L’ADN mit est particulièrement sensible aux agents mutagènes (de 10 à 20 fois plus que l’ADN nucléaire. Il est peu protégé par des protéines. Par ailleurs, les accidents survenant lors de la réplication peuvent difficilement être réparés.
- Utilisation : Le génome mitochondrial peut présenter des avantages pour l’agriculture : souvent, les plantes mâles stériles (femelles fertiles, donc qui transmettent leur génome mitochondrial) présentent des gènes résistants aux champignons, parasites, permettent de fabriquer plus de grains ou de fleurs…
Références, Bibliographie
http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/mitochondrie.htm
http://www.ese.u-psud.fr/rap_ura/evol/evol_pub.htm
Cours de Mr Stall SV1
Cours de Mr JJ Curgy
Encyclopaedia Universalis France SA 1998